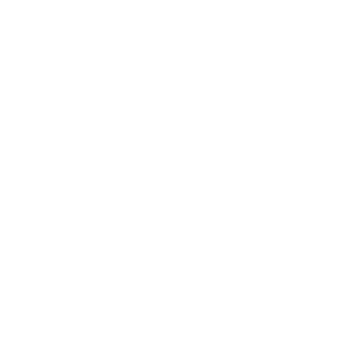La violence explose et les victimes se taisent
Le 30 octobre 2025, le ministère de l’Intérieur a publié sa dernière enquête menée en 2024 sur le « Vécu et ressenti en matière de sécurité » (VSR). Les chiffres sont sans équivoque : l’insécurité n’est plus un simple sentiment, elle s’installe dans le quotidien d’un nombre croissant de Français.
Ces dernières années, les atteintes aux biens et aux personnes ont connu une hausse alarmante. En effet, on observe une augmentation de 16 % des violences sexuelles, soit 243 000 victimes supplémentaires entre 2022 et 2023. Même constat pour les menaces, dont la hausse atteint 12 % sur la même période. Les femmes demeurent les premières victimes, représentant 84 % des violences sexuelles recensées en 2023. Pourtant, à peine 3 % d’entre elles déposent plainte auprès des autorités compétentes : un silence qui révèle l’absence de confiance envers le système judiciaire et le sentiment d’abandon des victimes.
Dans son enquête, le ministère de l’Intérieur pose la question du « sentiment d’insécurité ». Le constat est sans appel : en 2024, 15 % des personnes âgées d’au moins 18 ans déclarent ne plus se sentir en sécurité à leur domicile, soit près de 950 000 Français supplémentaires en un an. Parallèlement, 22 % des Français jugent leur quartier risqué, et 1 Français sur 5 reconnait ne plus oser sortir de chez lui à certains moments. Cette peur ne s’arrête pas aux portes des résidences : elle s’étend bien au-delà, touchant aussi les transports et leurs infrastructures, où 42 % des individus se sentent vulnérables, un chiffre qui monte à 48 % chez les femmes, notamment dans l’unité urbaine parisienne.
Les jeunes en première ligne
Les jeunes âgés de 18 à 24 ans apparaissent comme l’une des populations les plus exposées à l’insécurité. Près de 3 sur 10 ne se sentent plus en sécurité dans leur quartier, et plus de la moitié, 53 %, se disent vulnérables dans les transports ou dans les gares, stations et aéroports. Cette génération, souvent perçue comme « connectée » et ouverte sur le monde, est paradoxalement celle qui subit le plus directement la délinquance. Confrontés à des violences quotidiennes, les jeunes voient leur liberté de mouvement se restreindre, remplacée par des comportements dictés par la peur.
Cette exposition constante nourrit un cercle vicieux. Plus les actes de délinquance se multiplient – infractions au Code de la route (44 %), dégradations et vandalisme (28 %), vols (24 %) –, plus le sentiment d’insécurité s’amplifie, renforçant la méfiance envers les institutions. Toute chose égale par ailleurs, moins d’une victime sur cinq porte plainte. Entre manque d’information, démarches jugées complexes et impression alarmante que « porter plainte n’aurait servi à rien », le silence des victimes traduit une érosion profonde de la confiance dans la justice.
Même si les statistiques officielles montrent une satisfaction stable envers l’action des forces de sécurité depuis 2015 – 56 % pour l’action nationale en 2024 et 53 % pour l’action locale –, elles masquent un fossé entre les discours et la réalité vécue. Pour de nombreux Français, la promesse de sécurité reste éloignée de leur expérience quotidienne. À cela s’ajoute une fracture plus profonde encore : celle qui sépare les citoyens de la justice. Selon un sondage CSA, 62 % des Français déclarent ne pas faire confiance à la justice pour sanctionner les auteurs de violences. Cette défiance cible notamment une magistrature perçue comme enfermée dans une logique abstraite, où le respect strict des procédures et la recherche d’équilibre semblent parfois primer sur le sentiment de justice lui-même. Beaucoup ne comprennent plus la distance entre les réalités de terrain et certaines décisions rendues.
Les citoyens doutent ainsi non seulement de l’efficacité de la justice, mais aussi de la capacité de ses magistrats à les protéger au quotidien. Dans les zones urbaines sensibles et les territoires périurbains, ce décalage nourrit un sentiment d’abandon particulièrement tangible. Les magistrats apparaissent comme les gardiens d’un système qui, au nom de principes légitimes – présomption d’innocence, réinsertion, indépendance – semble avoir perdu de vue l’exigence de fermeté face à la violence quotidienne. Cette perception nourrit l’idée d’une justice trop théorique, déconnectée de la peur, de la vulnérabilité et du désarroi de ceux qui vivent l’insécurité au quotidien. Restaurer la confiance et rétablir la sécurité devient un impératif, non plus comme un simple objectif politique, mais comme un droit fondamental pour chaque citoyen. Cela passera moins par des slogans que par une justice plus lisible, plus proche et pleinement consciente de son impact sur le lien social et la protection des victimes.
Sous-représentation et illusions statistiques
Pour comprendre pleinement l’ampleur de ces chiffres, il faut aussi regarder la méthodologie de l’enquête. Si l’échantillon est conséquent – 200 000 personnes – sa composition ne reflète pas exactement la diversité sociale du pays. Seuls 5 % des répondants résident en quartier prioritaire, soit environ 10 000 personnes, alors que ces territoires représentent 8 % de la population française. À l’inverse, 24 % des répondants appartiennent aux 20 % des ménages les plus aisés, soit près de 48 000 personnes.
Cette surreprésentation des catégories favorisées, combinée à la sous-représentation des zones les plus exposées à la délinquance, crée un paradoxe, qui souligne la nécessité de replacer les résultats dans le contexte de la composition de l’échantillon. Même avec un échantillon relativement moins confronté aux risques, l’enquête révèle une hausse notable de l’insécurité. On peut donc imaginer que la réalité vécue dans les zones les plus vulnérables est encore plus inquiétante.
Pour des solutions concrètes, centrées sur les victimes
Face à l’insécurité grandissante et au silence des victimes, il est urgent d’agir pour garantir leur protection et restaurer la confiance des Français dans la justice. L’Institut pour la Justice propose que les victimes soient accompagnées dès le dépôt de plainte, avec la présence d’un avocat de garde dans les commissariats pour les aider à formaliser correctement leur démarche et réduire le stress lié aux procédures. L’extension de l’aide juridictionnelle permettrait que chacun, même dans le cadre des délits les plus graves, puisse bénéficier d’une représentation efficace et adaptée.
Nous estimons également essentiel de renforcer les droits des victimes dans le procès pénal. Elles doivent pouvoir contester les décisions pénales en cour d’assises ou tribunal correctionnel, et recevoir rapidement les dommages et intérêts auxquels elles ont droit. Une partie des amendes infligées aux délinquants pourrait être directement affectée à leur indemnisation, pour que la justice soit réellement au service de ceux qui en souffrent.
La protection doit aussi se déployer dans les lieux les plus exposés, notamment les quartiers sensibles et les transports. La prévention de la délinquance du quotidien, combinée à une tolérance zéro pour les criminels les plus dangereux et à un suivi strict après leur peine, permettrait de réduire les craintes et d’assurer la sécurité des citoyens.
Enfin, il est crucial de restaurer la confiance dans les acteurs de la justice. Garantir la neutralité et la responsabilité des magistrats, améliorer leur formation et diversifier les profils qui accèdent à la magistrature sont des orientations indispensables pour que les victimes se sentent entendues et protégées.
Ces mesures marqueraient un tournant : un dossier ne doit plus être un simple numéro que l’on classe, mais une ou des victimes que l’on doit protéger. Briser la peur, faire taire l’impunité, rendre à chaque citoyen la sécurité qu’il exige de droit. La justice n’a pas pour rôle de comprendre le crime, mais de le contenir.