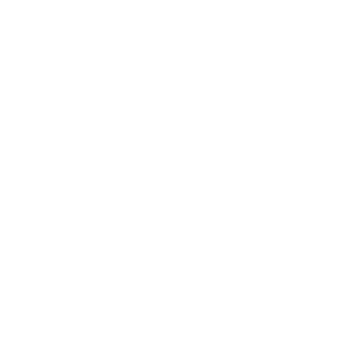Depuis quarante ans, plusieurs ministres de la Justice ont façonné un système où la fermeté s’est dissoute dans les doctrines, les expérimentations idéologiques et les réformes déconnectées du réel. Résultat : la justice est saturée, lente, et incapable de neutraliser les criminels. Ce Top 5 des pires ministres de la Justice illustre l’ampleur du désarmement de la justice française.
TOP 5 — Rachida Dati : la réinsertion au détriment de la sanction
L’ère Dati a gravé un paradoxe durable dans notre logiciel pénal. D’un côté, un discours ferme avec le retour des peines planchers mais dans les faits, une expansion de la réinsertion qui considère la prison comme l’ultime recours.
Principale mesure à retenir de la présence de Rachida Dati, c’est l’aménagement très fortement encouragé de toute peine de moins de 2 ans d’emprisonnement ferme. Selon ce mécanisme, tout délinquant condamné à 2 ans de prison ferme ou moins, pouvait (et en pratique le plus souvent, devait) voir sa peine aménagée dès l’audience. Dès lors, le délinquant condamné à de la prison ferme pouvait donc ressortir libre du tribunal, la cheville assortie d’un bracelet électronique.
Le but poursuivi ? Désengorger les prisons, au risque d’engorger nos rues de délinquants…
TOP 4 — Nicole Belloubet : une réforme pour rien
Nicolas Belloubet n’a pas laissé un souvenir impérissable de son passage Place Vendôme. Citons sa réforme de la justice pénale des mineurs de 2019, mise en place par ordonnance sous Dupond-Moretti, ce code sanctuarise le dogme du “tout-éducatif”. Interrogeons-nous également sur la césure du procès, mécanisme étrange vidant la sanction de son effet dissuasif. C’est l’acte final du renoncement : une justice qui s’épuise à comprendre le coupable plutôt qu’à protéger la société.
Mais on retiendra surtout de la période Belloubet la libération de plus de 6 000 détenus lors de la période du Covid, entraînant certes une respiration pour le système pénitentiaire, mais qui fût évidemment de courte durée, et surtout très dommageable pour l’effet dissuasif de la sanction.
Des milliers de détenus ont alors eu l’impression de recevoir leurs cadeaux de Noël avant l’heure en étant libérés sans égard quelconque pour leur comportement en prison. La seule motivation de ces libérations étant d’alléger les prisons….
TOP 3 — Éric Dupond-Moretti : une plaidoirie sans verdict pénal
De surcroit, sous Éric Dupond-Moretti, le ministère de la Justice a cessé d’être un pilier régalien pour devenir une scène médiatique. Sa nomination a fait couler beaucoup d’encre, et l’ex-avocat s’est trop souvent comporté comme s’il plaidait devant l’opinion : postures, coups d’éclat, invectives… mais aucune stratégie pénale solide. D’autant que ces coups d’éclat, s’ils ont pu avoir un intérêt lors de sa carrière d’avocat, sont devenus des boulets à l’heure de discuter et de négocier avec des magistrats qui ne lui ont fait aucun cadeau.
Sa mise en examen, sur fond de contestation véhémente de la part des syndicats de magistrats, et qui n’a pas abouti sur une condamnation, était une première historique pour un ministre de la Justice en exercice. Pendant ce chaos médiatique, la politique pénale reste au point mort. Aucune réforme pénale crédible, aucune solution contre la récidive : rien. Il a alors choisi durant quatres longues années d’être le ministre du “sentiment d’insécurité”, niant notamment avec une particulière énergie l’existence du notoire laxisme de la Justice...
TOP 2 — Christiane Taubira ou le démantèlement de la réponse pénale
Avec Christiane Taubira, la justice pénale a basculé dans une logique où l’aménagement devenait la règle, et l’incarcération, l’exception. Sa loi de 2014, présentée comme « humaniste », a en réalité ouvert un cycle où même les délinquants multirécidivistes peuvent échapper à la prison ou en sortir très rapidement.
La première rupture fut la suppression des peines plancher. Conçues pour limiter l’impunité des récidivistes, elles devaient garantir une réponse ferme après plusieurs condamnations. Leur disparition a alors immédiatement fragilisé notre arsenal pénal : la récidive est redevenue négociable alors qu’elle aurait dû entraîner une sanction renforcée. Pour ne pas arranger le problème de la suroccupation carcérale, elle a, dès son arrivée place Vendôme, décidé du gel et de la réforme du plan de construction de prisons initié par François Fillon. Elle aura réussi à annuler 30 à 36 projets de nouveaux établissements, mettant à mal l’objectif initial de 80 000 places de prison à l’horizon 2017.
Le discours officiel évoquait des solutions « individualisées », mais dans les faits, l’alternative est devenue un réflexe quasi automatique, appliquée y compris à des profils dont le casier compte parfois des dizaines de condamnations. La priorité n’est plus la sécurité, mais la réduction du recours à l’incarcération.
Ainsi, dans l’élan de cette vision aux allures progressistes, la notion de responsabilité individuelle a fini par se dissoudre dans un ensemble de facteurs sociaux, psychologiques ou économiques.
L’opinion publique ne s’est pas faite attendre pour critiquer ce bilan. Avec 82% des Français souhaitant le rétablissement des peines plancher selon un sondage CSA de septembre 2024, il s’agit là d’une illustration du fossé béant entre la justice et les citoyens, qui voient des condamnés repartir trop vite, trop facilement et bien trop souvent. Une politique pénale qui prétendait apaiser… mais qui a surtout désarmé l’autorité judiciaire face à la criminalité.
TOP 1 — Robert Badinter, fossoyeur de la justice répressive
Robert Badinter n’a pas seulement aboli la peine de mort. Il a imposé lui-même la doctrine de la gauche judiciaire. C’est lui qui a ancré l’idée que la sévérité serait une faute morale, que la prison serait un échec, et que l’État devait comprendre les criminels avant de les neutraliser.
Avec la suppression de la loi « Sécurité et Liberté » d’Alain Peyrefitte, de la Cour de sûreté de l’État, de la “loi anticasseurs” et des quartiers de haute sécurité, Badinter a démantelé les outils qui permettaient de répondre rapidement et fermement à la délinquance violente. En quelques mois, l’ossature sécuritaire de la France a été démontée au nom d’une vision humaniste, déjà ignorante de la montée des violences.
La Justice française ne s’est jamais remise de son passage comme ministre. En prenant le problème à l’envers, il a gravé le dogmatisme dans la politique pénale, considérant le criminel comme victime de la société, la sanction comme ultime recours et la sévérité comme un archaïsme.
En quarante ans, l’héritage Badinter est devenu le carcan d’une France qui ne sait plus se défendre : une justice de la plaidoirie permanente où la responsabilité individuelle s’efface derrière le déterminisme social, et où l’impunité est devenue le prix à payer pour une certaine idée de la vertu.
Quatre décennies de dérives pénales
De Badinter à Dupond-Moretti, la trajectoire de la Justice française se lit comme un long renoncement et un tournant doctrinal majeur. Pendant quarante ans, le dogme de l’individualisation a servi de paravent à une défiance maladive envers l’incarcération et la sanction, transformant la répression en un banal accompagnement social et la prison en une option de second rang. Cette perte de lisibilité a produit une justice à deux vitesses : d’un côté, une procédure lente et imprévisible ; de l’autre, des récidivistes installés au cœur du système, bénéficiant d’une mansuétude frôlant la complicité.
Cette dérive n’a rien de spontané : elle procède d’une prise de contrôle idéologique progressive du ministère, que nous détaillons dans notre article sur l’emprise de l’idéologie sur le ministère de la Justice.
Sortir de cette impasse exigera plus qu’une simple réforme. Rétablir la confiance passera alors par une véritable révolution pénale, portée par un gouvernement qui cessera enfin de chercher des excuses aux délinquants pour se consacrer à la défense des victimes et à la restauration de l’ordre républicain.